- Article
- Source : Campus Sanofi
- 23 sept. 2025
HRC sur écoute : un nouveau podcast dédié au HRC
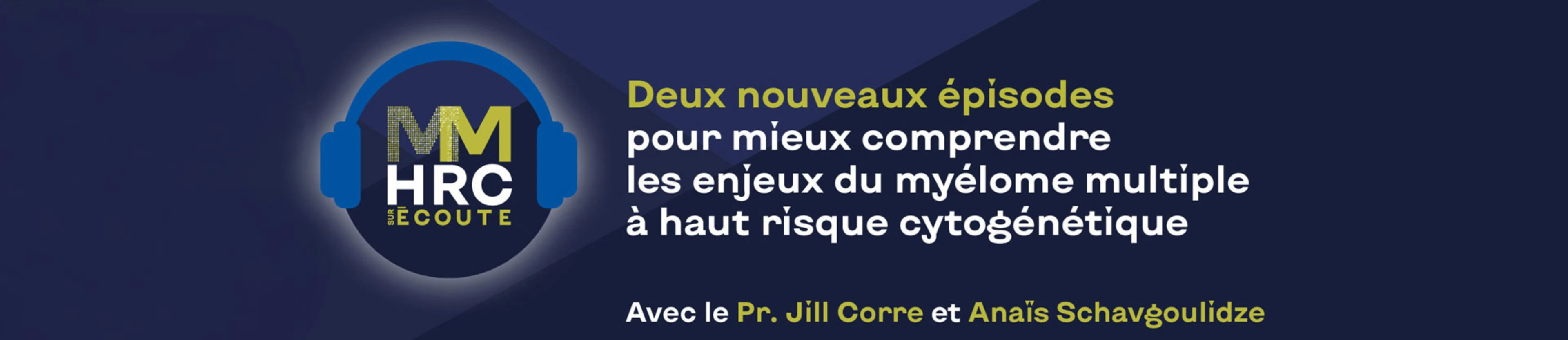
Dans le contexte actuel d’avancées thérapeutiques importantes, il était nécessaire de mettre à jour la notion de myélome de haut risque cytogénétique. Pour actualiser le R2-ISS (Revised 2 - International Staging System) de 2022,1 la Société Internationale du Myélome (IMS) s’est réunie pour proposer une définition actualisée du haut risque cytogénétique dans le myélome multiple.2
Les critères cytogénétiques retenus pour définir un haut risque (HR) sont les suivants :
- Délétion 17p et/ou présence d’une mutation de TP53
- Délétion 1p32 bi-allélique
- Gain du bras long du chromosome 1 (gain 1q) associé à une délétion 1p32 monoallélique
- Association entre : un gain 1q ou une délétion 1p32 monoallélique avec une translocation à risque, parmi les 3 suivantes :
- t(4;14)
- t(14;16)
- t(14;20)2
En complément de ces 4 critères cytogénétiques, le consensus a ajouté un critère biochimique qui est la présence d’un taux élevé de bêta-2 microglobuline chez les patients qui ont une fonction rénale préservée (créatinine normale).2
Enfin, le consensus a précisé qu’une délétion 17p était considérée comme significative lorsqu’elle est présente dans plus de 20 % des plasmocytes tumoraux.2
Le Pr Jill Corre et Anaïs Schavgoulidze sont toutes deux biologistes médicales à l’Unité de génomique du myélome au CHU de Toulouse. Elles sont également membres d’une équipe de recherche concentrant son activité sur la génomique et l’immunologie du myélome au Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse (CRCT).
-
D'Agostino M et al. Second Revision of the International Staging System (R2-ISS) for Overall Survival in Multiple Myeloma: A European Myeloma Network (EMN) Report Within the HARMONY Project. J Clin Oncol. 2022;40(29):3406-18.
-
Avet-Loiseau H et al. International Myeloma Society/International Myeloma Working Group Consensus Recommendations on the Definition of High-Risk Multiple Myeloma. J Clin Oncol. 2025:JCO2401893. doi: 10.1200/JCO-24-01893.
Cet épisode permet de revenir sur l’évolution de la notion de myélome multiple à haut risque. Anaïs Schavgoulidze et le Pr Jill Corre présentent également les nouveaux critères de haut risque cytogénétique tels qu’ils ont été proposés en 2025 par la Société Internationale du Myélome. Elles abordent la notion d’ « ultra haut risque » et évoquent les défis qui subsistent encore aujourd’hui pour stratifier, avec encore davantage de précision, les patients dans la catégorie haut risque. En conclusion de l’épisode, les deux biologistes soulignent l’importance du haut risque fonctionnel, à l’intersection entre le niveau de risque initial et la qualité de la réponse thérapeutique.
Bonjour à tous, je suis le Professeur Jill Corre.
Bonjour, je suis Anaïs Schavgoulidze.
Anaïs et moi sommes toutes deux biologistes médicales à l’Unité de Génomique du Myélome au CHU de Toulouse, et nous appartenons à une équipe de recherche dédiée à l’étude de la génomique et l’immunologie du myélome au Centre de recherches en cancérologie de Toulouse.
Bienvenue dans ce 1er épisode de ce podcast consacré au myélome multiple de haut risque cytogénétique. Aujourd’hui, nous allons retracer l’évolution des critères de définition du haut risque, revenir sur les avancées les plus récentes du consensus international et évoquer des pistes pour le futur...
Alors quels ont été les premiers critères pour identifier les myélomes multiples de haut risque et comment la définition de « haut risque » a-t-elle évolué au fil des années ?
À l’origine, la définition du myélome multiple à haut risque reposait sur des critères purement biochimiques, principalement le taux de bêta-2 microglobuline et l’albumine. En parallèle, des études ont commencé à explorer l’impact pronostique des anomalies cytogénétiques portées par les plasmocytes tumoraux, notamment la délétion du chromosome 13.
En 2015, la classification ISS initialement fondée uniquement sur des paramètres biochimiques a été révisée pour donner naissance au score R-ISS. Ce dernier a intégré pour la première fois trois anomalies cytogénétiques considérées comme de haut risque :
- La délétion 17p
- La translocation (4;14)
- La translocation (14;16).
Cependant, ce score n’a pas fait l’unanimité. Certaines études ont montré que le R-ISS ne permettait pas toujours d’identifier avec précision tous les patients à haut risque, certains étant à tort classés en risque intermédiaire.
Tout à fait. Et en 2022 une seconde révision a donc été proposée avec le score R2-ISS, qui intègre des anomalies supplémentaires, telles que le gain 1q, reconnues comme étant associées à un pronostic défavorable.
Parallèlement aux scores internationaux validés par l’IMWG, l’IFM a développé un score spécifique : le LP-Score. Contrairement aux précédents, ce score est exclusivement basé sur 5 anomalies cytogénétiques considérées comme à risque :
- Délétion 17p
- Délétion 1p32
- Gain 1q
- Translocation (4;14)
- Trisomie 21.4
Et le LP-score intègre également une anomalie considérée comme protectrice : la trisomie 5.
Chaque anomalie se voit attribuer un coefficient, et la somme des coefficients permet de classer les patients en trois catégories de risque : risque favorable, Risque intermédiaire et Haut risque.
En 2022, deux scores coexistent donc dans la pratique : le R2-ISS, utilisé à l’échelle internationale, et le LP-Score, plus répandu en France.
Aujourd’hui, comment est défini un myélome multiple de haut risque cytogénétique ?
Face à l’absence de consensus clair sur la notion de « haut risque » dans le myélome multiple, notamment à l’ère des traitements innovants, la Société Internationale du Myélome s’est récemment réunie pour proposer une définition actualisée. Cette nouvelle classification a été publiée dans le Journal of Clinical Oncology.
Elle repose sur quatre critères cytogénétiques majeurs. Voici les critères cytogénétiques retenus pour définir un haut risque :
- Un premier groupe avec la présence d’une délétion 17p et/ou la présence d’une mutation de TP53
- Un deuxième critère avec la présence d’une délétion 1p32 bi-allélique
- Un troisième groupe qui concerne l’association du gain du bras long du chromosome 1 (le gain 1q) avec une délétion 1p32 monoallélique
- Et enfin un quatrième groupe qui porte sur l’association entre un gain 1q ou une délétion 1p32 monoallélique avec une translocation à risque, parmi les 3 suivantes :
- La t(4;14)
- La t(14;16)
- Et la t(14;20)
En complément de ces 4 critères cytogénétiques, le consensus a ajouté un critère biochimique qui est la présence d’un taux élevé de bêta-2 microglobuline chez les patients qui ont une fonction rénale préservée, autrement dit une créatinine normale.
Enfin, le consensus a précisé qu’une délétion 17p était considérée comme significative lorsqu’elle est présente dans plus de 20 % des plasmocytes tumoraux. Cette définition a toutefois suscité un certain débat, car certaines études suggèrent que lorsque la délétion 17p ne concerne pas la majorité des plasmocytes, elle pourrait correspondre à un profil à risque intermédiaire plutôt qu’à un haut risque avéré. Quoi qu’il en soit, il est essentiel, lors d’une recherche de délétion 17p par FISH, de préciser systématiquement le pourcentage de plasmocytes porteurs de l’anomalie afin d’affiner le pronostic.
Alors, j’ajouterais une chose : cette définition a été pensée pour qu’environ 20 % des patients nouvellement diagnostiqués soient classés comme « haut risque ». À titre de comparaison, dans la précédente classification internationale, le stade R-ISS III et le score LP haut risque de l’IFM ne concernaient qu’environ 15 % des patients.
Et comment est défini un myélome multiple d’ultra-haut risque ?
Le consensus IMS n’a pas défini formellement le concept d’ultra-haut risque cytogénétique. En pratique, on se base sur des critères cliniques, notamment la survie globale c’est-à-dire un décès dans les 2 ans après le diagnostic va être considéré comme un marqueur d’ultra-haut risque. Une survie inférieure à 3 ans correspond à un haut risque.
D’un point de vue génétique, certains cliniciens considèrent qu’une combinaison de deux anomalies de mauvais pronostic (par exemple un gain 1q + une translocation (4;14)) peut suggérer un profil « ultra-haut risque ». Cependant, cette approche reste empirique et n’est pas encore standardisée.
Il existe néanmoins des profils biologiquement très défavorables, par exemple l’association d’une délétion 17p et d’une mutation TP53, qui entraînent une inactivation bi-allélique de TP53. Ce type de myélome est reconnu comme particulièrement agressif, bien que non encore officiellement catalogué comme « ultra-haut risque » dans les classifications actuelles.
L’un des objectifs du consensus a été de clarifier ces situations confuses : certains profils autrefois considérés comme « ultra-haut risque » sont désormais intégrés dans la nouvelle catégorie dite de « haut risque », grâce à une meilleure précision des outils de diagnostic.
La nouvelle définition permet de reclasser un certain nombre de patients, notamment ceux qui étaient autrefois considérés comme à risque intermédiaire dans le R-ISS. Par exemple, tous les patients au stade R-ISS II porteurs d’une délétion 17p sont désormais automatiquement considérés comme haut risque. On pourrait estimer de manière empirique qu’environ 1 patient sur 5 classé en haut risque selon cette nouvelle définition pourrait relever du profil « ultra-haut risque », mais bien sûr ce sous-groupe reste à mieux caractériser dans les années à venir.
Quels défis subsistent aujourd’hui pour stratifier avec encore davantage de précision les patients dans la catégorie des haut risques ?
L’un des grands enjeux, c’est d’avoir accès à des cohortes suffisamment larges. C’est ce qui a permis, par exemple, à Anaïs d’identifier la double délétion 1p32, une anomalie rare mais à fort impact pronostique. Le myélome est une maladie très hétérogène et, sans un nombre important de patients, on risque de passer à côté de facteurs extrêmement péjoratifs qui ne concernent qu’une petite minorité. C’est pour ça que les grandes cohortes sont essentielles.
Un autre défi, c’est celui de l’hétérogénéité spatiale. Chez certains patients, si on compare un prélèvement sternal et un prélèvement iliaque, on peut ne pas retrouver les mêmes anomalies cytogénétiques. Il arrive qu’un patient soit classé « risque standard » dans le sternum, et « haut risque » dans le bassin. Pourtant, son pronostic global est bien celui d’un « haut risque ». C’est ce qui pousse aujourd’hui au développement d’outils capables de détecter les anomalies cytogénétiques directement dans le sang. Il y a encore une quinzaine d’années, on pensait qu’il n’y avait pas de plasmocytes tumoraux circulants dans le myélome. Mais avec les nouvelles techniques de cytométrie en flux plus sensibles, on sait aujourd’hui qu’il y en a un petit pourcentage circulant. Et ce taux de cellules tumorales circulantes a un impact pronostique. Plusieurs équipes européennes ont identifié un seuil pronostique autour de 0,02 % : au-delà de ce seuil, le pronostic est plus défavorable.
Donc il y a à la fois un aspect quantitatif — plus il y a de cellules en circulation, plus c’est péjoratif — et un aspect qualitatif, car si on peut séquencer ces cellules, on pourrait accéder théoriquement à l’hétérogénéité génétique sans passer par des prélèvements médullaires multiples.
Et au-delà de la génétique, il faudra aussi prendre en compte le microenvironnement tumoral, en particulier l’état du système immunitaire du patient. On sait par exemple que la qualité des lymphocytes T influence la réponse aux immunothérapies. Ce sont des aspects qui restent encore à explorer plus en profondeur.
Ajoutons que même si aujourd’hui les panels NGS sont courants, ils ne donnent qu’une partie des informations. En séquençant l’intégralité du génome, on peut accéder à des données qu’on ne voit pas avec un panel classique, par exemple, certains marqueurs d’instabilité génétique comme la signature mutationnelle APOBEC. Et plus une tumeur est instable, plus elle est agressive. L’un des grands défis à venir, ce sera donc de rendre ces données accessibles en pratique, même si on ne peut pas faire un séquençage complet du génome de tous les patients à grande échelle pour le moment.
Enfin, il y a la question de l’intégration de toutes ces données — génétiques, immunitaires, cytométriques — pour obtenir une évaluation personnalisée du risque et proposer des traitements mieux adaptés. Là-dessus, l’intelligence artificielle jouera sans doute un rôle important : elle pourrait nous aider à croiser ces informations complexes pour affiner les prises de décision.
Dans le futur, pourrait-on envisager des définitions de haut risque basées sur le niveau de MRD après l’induction ?
Aujourd’hui, on s’appuie principalement sur des éléments présents au diagnostic : les anomalies cytogénétiques, la bêta-2, la présence éventuelle de cellules tumorales circulantes, etc. Mais ce qui est aussi majeur, c’est : « qu’est-ce qui se passe ensuite ? ».
Oui, c’est là qu’on entre dans la notion de haut risque fonctionnel. Autrement dit : comment le patient répond au traitement ? Et c’est probablement cette intersection entre le niveau de risque initial et la qualité de la réponse thérapeutique qui sera clé à l’avenir.
Aujourd’hui, le meilleur critère pour évaluer cette réponse, c’est la maladie résiduelle minimale, la MRD. Et ce qu’il faut retenir, c’est que chez un patient à haut risque, le fait d’obtenir une MRD indétectable maintenue dans le temps doit devenir un objectif thérapeutique à part entière.
Voilà... Je pense qu’on a abordé l’essentiel sur la thématique « Définir et comprendre le myélome multiple de haut risque cytogénétique ». Merci à tous pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dédié au myélome de haut risque. Vous pouvez retrouver cet épisode et le suivant sur le site Sanofi Campus. A bientôt !
4. Perrot A et al. Development and Validation of a Cytogenetic Prognostic Index Predicting Survival in Multiple Myeloma. J Clin Oncol. 2019;37(19):1657-1665.
Bonjour à tous, je suis le Professeur Jill Corre.
Bonjour, je suis Anaïs Schavgoulidze.
Anaïs et moi sommes toutes deux biologistes médicales à l’Unité de Génomique du Myélome au CHU de Toulouse, et nous appartenons à une équipe de recherche dédiée à l’étude de la génomique et l’immunologie du myélome au Centre de recherches en cancérologie de Toulouse.
Bienvenue dans ce 1er épisode de ce podcast consacré au myélome multiple de haut risque cytogénétique. Aujourd’hui, nous allons retracer l’évolution des critères de définition du haut risque, revenir sur les avancées les plus récentes du consensus international et évoquer des pistes pour le futur...
Alors quels ont été les premiers critères pour identifier les myélomes multiples de haut risque et comment la définition de « haut risque » a-t-elle évolué au fil des années ?
À l’origine, la définition du myélome multiple à haut risque reposait sur des critères purement biochimiques, principalement le taux de bêta-2 microglobuline et l’albumine. En parallèle, des études ont commencé à explorer l’impact pronostique des anomalies cytogénétiques portées par les plasmocytes tumoraux, notamment la délétion du chromosome 13.
En 2015, la classification ISS initialement fondée uniquement sur des paramètres biochimiques a été révisée pour donner naissance au score R-ISS. Ce dernier a intégré pour la première fois trois anomalies cytogénétiques considérées comme de haut risque :
- La délétion 17p
- La translocation (4;14)
- La translocation (14;16).
Cependant, ce score n’a pas fait l’unanimité. Certaines études ont montré que le R-ISS ne permettait pas toujours d’identifier avec précision tous les patients à haut risque, certains étant à tort classés en risque intermédiaire.
Tout à fait. Et en 2022 une seconde révision a donc été proposée avec le score R2-ISS, qui intègre des anomalies supplémentaires, telles que le gain 1q, reconnues comme étant associées à un pronostic défavorable.
Parallèlement aux scores internationaux validés par l’IMWG, l’IFM a développé un score spécifique : le LP-Score. Contrairement aux précédents, ce score est exclusivement basé sur 5 anomalies cytogénétiques considérées comme à risque :
- Délétion 17p
- Délétion 1p32
- Gain 1q
- Translocation (4;14)
- Trisomie 21.4
Et le LP-score intègre également une anomalie considérée comme protectrice : la trisomie 5.
Chaque anomalie se voit attribuer un coefficient, et la somme des coefficients permet de classer les patients en trois catégories de risque : risque favorable, Risque intermédiaire et Haut risque.
En 2022, deux scores coexistent donc dans la pratique : le R2-ISS, utilisé à l’échelle internationale, et le LP-Score, plus répandu en France.
Aujourd’hui, comment est défini un myélome multiple de haut risque cytogénétique ?
Face à l’absence de consensus clair sur la notion de « haut risque » dans le myélome multiple, notamment à l’ère des traitements innovants, la Société Internationale du Myélome s’est récemment réunie pour proposer une définition actualisée. Cette nouvelle classification a été publiée dans le Journal of Clinical Oncology.
Elle repose sur quatre critères cytogénétiques majeurs. Voici les critères cytogénétiques retenus pour définir un haut risque :
- Un premier groupe avec la présence d’une délétion 17p et/ou la présence d’une mutation de TP53
- Un deuxième critère avec la présence d’une délétion 1p32 bi-allélique
- Un troisième groupe qui concerne l’association du gain du bras long du chromosome 1 (le gain 1q) avec une délétion 1p32 monoallélique
- Et enfin un quatrième groupe qui porte sur l’association entre un gain 1q ou une délétion 1p32 monoallélique avec une translocation à risque, parmi les 3 suivantes :
- La t(4;14)
- La t(14;16)
- Et la t(14;20)
En complément de ces 4 critères cytogénétiques, le consensus a ajouté un critère biochimique qui est la présence d’un taux élevé de bêta-2 microglobuline chez les patients qui ont une fonction rénale préservée, autrement dit une créatinine normale.
Enfin, le consensus a précisé qu’une délétion 17p était considérée comme significative lorsqu’elle est présente dans plus de 20 % des plasmocytes tumoraux. Cette définition a toutefois suscité un certain débat, car certaines études suggèrent que lorsque la délétion 17p ne concerne pas la majorité des plasmocytes, elle pourrait correspondre à un profil à risque intermédiaire plutôt qu’à un haut risque avéré. Quoi qu’il en soit, il est essentiel, lors d’une recherche de délétion 17p par FISH, de préciser systématiquement le pourcentage de plasmocytes porteurs de l’anomalie afin d’affiner le pronostic.
Alors, j’ajouterais une chose : cette définition a été pensée pour qu’environ 20 % des patients nouvellement diagnostiqués soient classés comme « haut risque ». À titre de comparaison, dans la précédente classification internationale, le stade R-ISS III et le score LP haut risque de l’IFM ne concernaient qu’environ 15 % des patients.
Et comment est défini un myélome multiple d’ultra-haut risque ?
Le consensus IMS n’a pas défini formellement le concept d’ultra-haut risque cytogénétique. En pratique, on se base sur des critères cliniques, notamment la survie globale c’est-à-dire un décès dans les 2 ans après le diagnostic va être considéré comme un marqueur d’ultra-haut risque. Une survie inférieure à 3 ans correspond à un haut risque.
D’un point de vue génétique, certains cliniciens considèrent qu’une combinaison de deux anomalies de mauvais pronostic (par exemple un gain 1q + une translocation (4;14)) peut suggérer un profil « ultra-haut risque ». Cependant, cette approche reste empirique et n’est pas encore standardisée.
Il existe néanmoins des profils biologiquement très défavorables, par exemple l’association d’une délétion 17p et d’une mutation TP53, qui entraînent une inactivation bi-allélique de TP53. Ce type de myélome est reconnu comme particulièrement agressif, bien que non encore officiellement catalogué comme « ultra-haut risque » dans les classifications actuelles.
L’un des objectifs du consensus a été de clarifier ces situations confuses : certains profils autrefois considérés comme « ultra-haut risque » sont désormais intégrés dans la nouvelle catégorie dite de « haut risque », grâce à une meilleure précision des outils de diagnostic.
La nouvelle définition permet de reclasser un certain nombre de patients, notamment ceux qui étaient autrefois considérés comme à risque intermédiaire dans le R-ISS. Par exemple, tous les patients au stade R-ISS II porteurs d’une délétion 17p sont désormais automatiquement considérés comme haut risque. On pourrait estimer de manière empirique qu’environ 1 patient sur 5 classé en haut risque selon cette nouvelle définition pourrait relever du profil « ultra-haut risque », mais bien sûr ce sous-groupe reste à mieux caractériser dans les années à venir.
Quels défis subsistent aujourd’hui pour stratifier avec encore davantage de précision les patients dans la catégorie des haut risques ?
L’un des grands enjeux, c’est d’avoir accès à des cohortes suffisamment larges. C’est ce qui a permis, par exemple, à Anaïs d’identifier la double délétion 1p32, une anomalie rare mais à fort impact pronostique. Le myélome est une maladie très hétérogène et, sans un nombre important de patients, on risque de passer à côté de facteurs extrêmement péjoratifs qui ne concernent qu’une petite minorité. C’est pour ça que les grandes cohortes sont essentielles.
Un autre défi, c’est celui de l’hétérogénéité spatiale. Chez certains patients, si on compare un prélèvement sternal et un prélèvement iliaque, on peut ne pas retrouver les mêmes anomalies cytogénétiques. Il arrive qu’un patient soit classé « risque standard » dans le sternum, et « haut risque » dans le bassin. Pourtant, son pronostic global est bien celui d’un « haut risque ». C’est ce qui pousse aujourd’hui au développement d’outils capables de détecter les anomalies cytogénétiques directement dans le sang. Il y a encore une quinzaine d’années, on pensait qu’il n’y avait pas de plasmocytes tumoraux circulants dans le myélome. Mais avec les nouvelles techniques de cytométrie en flux plus sensibles, on sait aujourd’hui qu’il y en a un petit pourcentage circulant. Et ce taux de cellules tumorales circulantes a un impact pronostique. Plusieurs équipes européennes ont identifié un seuil pronostique autour de 0,02 % : au-delà de ce seuil, le pronostic est plus défavorable.
Donc il y a à la fois un aspect quantitatif — plus il y a de cellules en circulation, plus c’est péjoratif — et un aspect qualitatif, car si on peut séquencer ces cellules, on pourrait accéder théoriquement à l’hétérogénéité génétique sans passer par des prélèvements médullaires multiples.
Et au-delà de la génétique, il faudra aussi prendre en compte le microenvironnement tumoral, en particulier l’état du système immunitaire du patient. On sait par exemple que la qualité des lymphocytes T influence la réponse aux immunothérapies. Ce sont des aspects qui restent encore à explorer plus en profondeur.
Ajoutons que même si aujourd’hui les panels NGS sont courants, ils ne donnent qu’une partie des informations. En séquençant l’intégralité du génome, on peut accéder à des données qu’on ne voit pas avec un panel classique, par exemple, certains marqueurs d’instabilité génétique comme la signature mutationnelle APOBEC. Et plus une tumeur est instable, plus elle est agressive. L’un des grands défis à venir, ce sera donc de rendre ces données accessibles en pratique, même si on ne peut pas faire un séquençage complet du génome de tous les patients à grande échelle pour le moment.
Enfin, il y a la question de l’intégration de toutes ces données — génétiques, immunitaires, cytométriques — pour obtenir une évaluation personnalisée du risque et proposer des traitements mieux adaptés. Là-dessus, l’intelligence artificielle jouera sans doute un rôle important : elle pourrait nous aider à croiser ces informations complexes pour affiner les prises de décision.
Dans le futur, pourrait-on envisager des définitions de haut risque basées sur le niveau de MRD après l’induction ?
Aujourd’hui, on s’appuie principalement sur des éléments présents au diagnostic : les anomalies cytogénétiques, la bêta-2, la présence éventuelle de cellules tumorales circulantes, etc. Mais ce qui est aussi majeur, c’est : « qu’est-ce qui se passe ensuite ? ».
Oui, c’est là qu’on entre dans la notion de haut risque fonctionnel. Autrement dit : comment le patient répond au traitement ? Et c’est probablement cette intersection entre le niveau de risque initial et la qualité de la réponse thérapeutique qui sera clé à l’avenir.
Aujourd’hui, le meilleur critère pour évaluer cette réponse, c’est la maladie résiduelle minimale, la MRD. Et ce qu’il faut retenir, c’est que chez un patient à haut risque, le fait d’obtenir une MRD indétectable maintenue dans le temps doit devenir un objectif thérapeutique à part entière.
Voilà... Je pense qu’on a abordé l’essentiel sur la thématique « Définir et comprendre le myélome multiple de haut risque cytogénétique ». Merci à tous pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dédié au myélome de haut risque. Vous pouvez retrouver cet épisode et le suivant sur le site Sanofi Campus. A bientôt !
4. Perrot A et al. Development and Validation of a Cytogenetic Prognostic Index Predicting Survival in Multiple Myeloma. J Clin Oncol. 2019;37(19):1657-1665.
Dans cet épisode, Anaïs Schavgoulidze présente les différents outils qui permettent d’identifier précisément les anomalies cytogénétiques : FISH et NGS. Elle évoque aussi les conséquences éventuelles liées à la nouvelle définition du myélome multiple à haut risque : mise en place d’essais cliniques spécifiquement dédiés aux patients à haut risque, prises en charge plus adaptées, développement de stratégies de maintenance plus efficaces...
Bonjour, je suis Anaïs Schavgoulidze. Bonjour je suis Jill Corre.
Nous sommes biologistes médicales à l’Unité de Génomique du Myélome au CHU de Toulouse, et nous appartenons à une équipe de recherche dédiée à l’étude de la génomique et l’immunologie du myélome au Centre de recherches en cancérologie de Toulouse.
Bienvenue dans ce 2ème épisode de ce podcast consacré au myélome multiple de haut risque cytogénétique. Aujourd’hui, nous allons parler outils diagnostiques et enjeux thérapeutiques.
Alors j’ai quelques questions pour toi Anaïs. Tout d’abord, quels sont les principaux outils qui permettent d’identifier précisément les anomalies cytogénétiques ?
Dans le myélome, le caryotype conventionnel, qui est pourtant une technique de base dans la plupart des hémopathies, est totalement inadapté. On utilise plutôt des techniques spécifiques, développées à partir de plasmocytes triés par tri immunomagnétique, c’est une vraie particularité du myélome. Et une fois ces cellules isolées, deux grands outils sont utilisés en pratique aujourd’hui : la FISH et les panels NGS.
Alors, rentrons un peu dans le détail de ces deux outils… La FISH tout d’abord. Elle est disponible dans tous les laboratoires de cytogénétique. C’est la technique la plus répandue, mais avec l’apparition des nouveaux scores de risque cytogénétique, on devrait théoriquement réaliser entre 6 et 8 FISH différentes pour couvrir toutes les anomalies pertinentes. Malheureusement, pour des raisons budgétaires, les laboratoires n’en font qu’une, généralement celle ciblant la délétion 17p, ce qui limite forcément l’informativité de l’analyse.
Les panels NGS, eux, ne sont accessibles que dans des laboratoires plus spécialisés. Actuellement, seulement deux centres publics en France proposent ce type d’analyse dédiée au myélome. Concrètement, pour réaliser un panel NGS, on extrait l’ADN des plasmocytes triés, on prépare une librairie et on capte les régions d’intérêt. L’intérêt du NGS, c’est qu’avec une seule technique, on peut obtenir l’ensemble des informations : anomalies de nombre, mutations, et même certaines translocations, comme la t(11;14), qui peut avoir un impact théranostique. Un point important : certaines anomalies très focales, comme une délétion bi-allélique de la 1p32, peuvent être manquées par la FISH mais bien détectées par le panel NGS.
C’est pour toutes ces raisons que, dans la pratique, beaucoup de cliniciens se tournent aujourd’hui vers le panel NGS. Enfin, on peut mentionner une technique émergente : l’Optical Genome Mapping, ou OGM, qui pourrait à terme devenir une alternative au caryotype et à la FISH. Elle commence à susciter un réel intérêt dans le myélome.
Comment les nouvelles définitions des myélomes multiples à haut risque influencent-elles les choix thérapeutiques et la prise en charge quotidienne des patients ?
A l’heure actuelle, il est fortement recommandé d’orienter les jeunes patients de haut risque vers l’autogreffe. Pour ces mêmes patients, les cliniciens essaient de les intégrer dans des essais cliniques, notamment sur des protocoles de maintenance intensifiée.
Des résultats d’études chez les patients âgés non éligibles à la greffe, avec une comparaison triplet vs quadruplet, montrent une meilleure efficacité de la quadruplet chez les patients à haut risque sur des données de MRD.
Pour l’instant, aucune molécule n’a clairement démontré sa capacité à compenser un haut risque cytogénétique, on observe encore des rechutes sous les nouveaux traitements d’immunothérapie. Prenons l’exemple des patients avec une délétion 17p, nous avons observé des associations plus fréquentes entre une délétion 17p et une délétion de BCMA, ce qui suggère un facteur favorisant de résistance plus rapide aux traitements anti-BCMA.
Quels bénéfices ces nouvelles définitions pourront-elles apporter en termes de survie et de qualité de vie pour les patients ?
L’espoir, c’est que ces nouvelles définitions permettent enfin de construire des essais cliniques spécifiquement dédiés aux patients à haut risque, avec des critères consensuels, partagés par tous. Aujourd’hui, la plupart des essais incluent des patients tout-venant, qu’on stratifie ensuite selon le risque. Mais on se retrouve avec des sous-groupes très réduits, ce qui rend les analyses très difficiles, et l’interprétation des données parfois hasardeuse. Avec une définition claire du haut risque, on pourrait vraiment encourager les promoteurs académiques et l’industrie pharmaceutique à concevoir des protocoles ciblés spécifiquement pour ces patients.
Le patient à haut risque, c’est un peu le « parent pauvre » du myélome : on sait qu’il a un mauvais pronostic, mais l’adaptation thérapeutique ne suit pas. Aujourd’hui encore, le traitement est principalement déterminé par l’âge et l’éligibilité à l’intensification, pas par le profil cytogénétique. Alors qu’en réalité, dès qu’un patient est identifié comme haut risque cytogénétique, il faudrait probablement en faire plus. C’est ce qui a conduit à envisager des stratégies comme la double autogreffe. Cela dit, des essais pourraient venir remettre en question cette approche. On est donc à un tournant. Ce qu’on voit, c’est que les cliniciens souhaitent pouvoir adapter leurs traitements au niveau de risque réel. Ils voient bien que ces patients vont moins bien… mais pour l’instant, on manque de réponses effectives.
Alors quelles pourraient être les nouvelles stratégies thérapeutiques pour le myélome multiple à haut risque cytogénétique ?
Ce que l’on constate avec les patients à haut risque, c’est qu’ils ont un risque de rechute plus rapide, même après une bonne réponse initiale. Donc l’objectif, ce serait de développer des stratégies de maintenance plus efficaces, plus longues, que celles qu’on propose actuellement en routine.
Par exemple, dans un essai, certains patients ont vu leur traitement interrompu après avoir atteint deux MRD négatives consécutives. Mais chez les patients à haut risque cytogénétique, même s’ils étaient MRD négatifs, on a observé des rechutes précoces après l’arrêt du traitement.
Cela montre bien que chez ces patients, on ne peut sans doute pas appliquer les mêmes stratégies d’arrêt que pour les autres. Il faudra probablement envisager des maintenances plus longues, voire personnalisées, en fonction du profil de risque.
Merci Anaïs, merci à tous pour votre écoute. J’espère que ce podcast a répondu à vos attentes. Vous pouvez retrouver cet épisode et le précédent ainsi que la première saison sur la maladie résiduelle sur le site Sanofi Campus.
Bonjour, je suis Anaïs Schavgoulidze. Bonjour je suis Jill Corre.
Nous sommes biologistes médicales à l’Unité de Génomique du Myélome au CHU de Toulouse, et nous appartenons à une équipe de recherche dédiée à l’étude de la génomique et l’immunologie du myélome au Centre de recherches en cancérologie de Toulouse.
Bienvenue dans ce 2ème épisode de ce podcast consacré au myélome multiple de haut risque cytogénétique. Aujourd’hui, nous allons parler outils diagnostiques et enjeux thérapeutiques.
Alors j’ai quelques questions pour toi Anaïs. Tout d’abord, quels sont les principaux outils qui permettent d’identifier précisément les anomalies cytogénétiques ?
Dans le myélome, le caryotype conventionnel, qui est pourtant une technique de base dans la plupart des hémopathies, est totalement inadapté. On utilise plutôt des techniques spécifiques, développées à partir de plasmocytes triés par tri immunomagnétique, c’est une vraie particularité du myélome. Et une fois ces cellules isolées, deux grands outils sont utilisés en pratique aujourd’hui : la FISH et les panels NGS.
Alors, rentrons un peu dans le détail de ces deux outils… La FISH tout d’abord. Elle est disponible dans tous les laboratoires de cytogénétique. C’est la technique la plus répandue, mais avec l’apparition des nouveaux scores de risque cytogénétique, on devrait théoriquement réaliser entre 6 et 8 FISH différentes pour couvrir toutes les anomalies pertinentes. Malheureusement, pour des raisons budgétaires, les laboratoires n’en font qu’une, généralement celle ciblant la délétion 17p, ce qui limite forcément l’informativité de l’analyse.
Les panels NGS, eux, ne sont accessibles que dans des laboratoires plus spécialisés. Actuellement, seulement deux centres publics en France proposent ce type d’analyse dédiée au myélome. Concrètement, pour réaliser un panel NGS, on extrait l’ADN des plasmocytes triés, on prépare une librairie et on capte les régions d’intérêt. L’intérêt du NGS, c’est qu’avec une seule technique, on peut obtenir l’ensemble des informations : anomalies de nombre, mutations, et même certaines translocations, comme la t(11;14), qui peut avoir un impact théranostique. Un point important : certaines anomalies très focales, comme une délétion bi-allélique de la 1p32, peuvent être manquées par la FISH mais bien détectées par le panel NGS.
C’est pour toutes ces raisons que, dans la pratique, beaucoup de cliniciens se tournent aujourd’hui vers le panel NGS. Enfin, on peut mentionner une technique émergente : l’Optical Genome Mapping, ou OGM, qui pourrait à terme devenir une alternative au caryotype et à la FISH. Elle commence à susciter un réel intérêt dans le myélome.
Comment les nouvelles définitions des myélomes multiples à haut risque influencent-elles les choix thérapeutiques et la prise en charge quotidienne des patients ?
A l’heure actuelle, il est fortement recommandé d’orienter les jeunes patients de haut risque vers l’autogreffe. Pour ces mêmes patients, les cliniciens essaient de les intégrer dans des essais cliniques, notamment sur des protocoles de maintenance intensifiée.
Des résultats d’études chez les patients âgés non éligibles à la greffe, avec une comparaison triplet vs quadruplet, montrent une meilleure efficacité de la quadruplet chez les patients à haut risque sur des données de MRD.
Pour l’instant, aucune molécule n’a clairement démontré sa capacité à compenser un haut risque cytogénétique, on observe encore des rechutes sous les nouveaux traitements d’immunothérapie. Prenons l’exemple des patients avec une délétion 17p, nous avons observé des associations plus fréquentes entre une délétion 17p et une délétion de BCMA, ce qui suggère un facteur favorisant de résistance plus rapide aux traitements anti-BCMA.
Quels bénéfices ces nouvelles définitions pourront-elles apporter en termes de survie et de qualité de vie pour les patients ?
L’espoir, c’est que ces nouvelles définitions permettent enfin de construire des essais cliniques spécifiquement dédiés aux patients à haut risque, avec des critères consensuels, partagés par tous. Aujourd’hui, la plupart des essais incluent des patients tout-venant, qu’on stratifie ensuite selon le risque. Mais on se retrouve avec des sous-groupes très réduits, ce qui rend les analyses très difficiles, et l’interprétation des données parfois hasardeuse. Avec une définition claire du haut risque, on pourrait vraiment encourager les promoteurs académiques et l’industrie pharmaceutique à concevoir des protocoles ciblés spécifiquement pour ces patients.
Le patient à haut risque, c’est un peu le « parent pauvre » du myélome : on sait qu’il a un mauvais pronostic, mais l’adaptation thérapeutique ne suit pas. Aujourd’hui encore, le traitement est principalement déterminé par l’âge et l’éligibilité à l’intensification, pas par le profil cytogénétique. Alors qu’en réalité, dès qu’un patient est identifié comme haut risque cytogénétique, il faudrait probablement en faire plus. C’est ce qui a conduit à envisager des stratégies comme la double autogreffe. Cela dit, des essais pourraient venir remettre en question cette approche. On est donc à un tournant. Ce qu’on voit, c’est que les cliniciens souhaitent pouvoir adapter leurs traitements au niveau de risque réel. Ils voient bien que ces patients vont moins bien… mais pour l’instant, on manque de réponses effectives.
Alors quelles pourraient être les nouvelles stratégies thérapeutiques pour le myélome multiple à haut risque cytogénétique ?
Ce que l’on constate avec les patients à haut risque, c’est qu’ils ont un risque de rechute plus rapide, même après une bonne réponse initiale. Donc l’objectif, ce serait de développer des stratégies de maintenance plus efficaces, plus longues, que celles qu’on propose actuellement en routine.
Par exemple, dans un essai, certains patients ont vu leur traitement interrompu après avoir atteint deux MRD négatives consécutives. Mais chez les patients à haut risque cytogénétique, même s’ils étaient MRD négatifs, on a observé des rechutes précoces après l’arrêt du traitement.
Cela montre bien que chez ces patients, on ne peut sans doute pas appliquer les mêmes stratégies d’arrêt que pour les autres. Il faudra probablement envisager des maintenances plus longues, voire personnalisées, en fonction du profil de risque.
Merci Anaïs, merci à tous pour votre écoute. J’espère que ce podcast a répondu à vos attentes. Vous pouvez retrouver cet épisode et le précédent ainsi que la première saison sur la maladie résiduelle sur le site Sanofi Campus.
Dans le contexte actuel d’avancées thérapeutiques importantes, il était nécessaire de mettre à jour la notion de myélome de haut risque cytogénétique. Pour actualiser le R2-ISS (Revised 2 - International Staging System) de 2022,1 la Société Internationale du Myélome (IMS) s’est réunie pour proposer une définition actualisée du haut risque cytogénétique dans le myélome multiple.2
Les critères cytogénétiques retenus pour définir un haut risque (HR) sont les suivants :
- Délétion 17p et/ou présence d’une mutation de TP53
- Délétion 1p32 bi-allélique
- Gain du bras long du chromosome 1 (gain 1q) associé à une délétion 1p32 monoallélique
- Association entre : un gain 1q ou une délétion 1p32 monoallélique avec une translocation à risque, parmi les 3 suivantes :
- t(4;14)
- t(14;16)
- t(14;20)2
En complément de ces 4 critères cytogénétiques, le consensus a ajouté un critère biochimique qui est la présence d’un taux élevé de bêta-2 microglobuline chez les patients qui ont une fonction rénale préservée (créatinine normale).2
Enfin, le consensus a précisé qu’une délétion 17p était considérée comme significative lorsqu’elle est présente dans plus de 20 % des plasmocytes tumoraux.2
Le Pr Jill Corre et Anaïs Schavgoulidze sont toutes deux biologistes médicales à l’Unité de génomique du myélome au CHU de Toulouse. Elles sont également membres d’une équipe de recherche concentrant son activité sur la génomique et l’immunologie du myélome au Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse (CRCT).
-
D'Agostino M et al. Second Revision of the International Staging System (R2-ISS) for Overall Survival in Multiple Myeloma: A European Myeloma Network (EMN) Report Within the HARMONY Project. J Clin Oncol. 2022;40(29):3406-18.
-
Avet-Loiseau H et al. International Myeloma Society/International Myeloma Working Group Consensus Recommendations on the Definition of High-Risk Multiple Myeloma. J Clin Oncol. 2025:JCO2401893. doi: 10.1200/JCO-24-01893.
Cet épisode permet de revenir sur l’évolution de la notion de myélome multiple à haut risque. Anaïs Schavgoulidze et le Pr Jill Corre présentent également les nouveaux critères de haut risque cytogénétique tels qu’ils ont été proposés en 2025 par la Société Internationale du Myélome. Elles abordent la notion d’ « ultra haut risque » et évoquent les défis qui subsistent encore aujourd’hui pour stratifier, avec encore davantage de précision, les patients dans la catégorie haut risque. En conclusion de l’épisode, les deux biologistes soulignent l’importance du haut risque fonctionnel, à l’intersection entre le niveau de risque initial et la qualité de la réponse thérapeutique.
Bonjour à tous, je suis le Professeur Jill Corre.
Bonjour, je suis Anaïs Schavgoulidze.
Anaïs et moi sommes toutes deux biologistes médicales à l’Unité de Génomique du Myélome au CHU de Toulouse, et nous appartenons à une équipe de recherche dédiée à l’étude de la génomique et l’immunologie du myélome au Centre de recherches en cancérologie de Toulouse.
Bienvenue dans ce 1er épisode de ce podcast consacré au myélome multiple de haut risque cytogénétique. Aujourd’hui, nous allons retracer l’évolution des critères de définition du haut risque, revenir sur les avancées les plus récentes du consensus international et évoquer des pistes pour le futur...
Alors quels ont été les premiers critères pour identifier les myélomes multiples de haut risque et comment la définition de « haut risque » a-t-elle évolué au fil des années ?
À l’origine, la définition du myélome multiple à haut risque reposait sur des critères purement biochimiques, principalement le taux de bêta-2 microglobuline et l’albumine. En parallèle, des études ont commencé à explorer l’impact pronostique des anomalies cytogénétiques portées par les plasmocytes tumoraux, notamment la délétion du chromosome 13.
En 2015, la classification ISS initialement fondée uniquement sur des paramètres biochimiques a été révisée pour donner naissance au score R-ISS. Ce dernier a intégré pour la première fois trois anomalies cytogénétiques considérées comme de haut risque :
- La délétion 17p
- La translocation (4;14)
- La translocation (14;16).
Cependant, ce score n’a pas fait l’unanimité. Certaines études ont montré que le R-ISS ne permettait pas toujours d’identifier avec précision tous les patients à haut risque, certains étant à tort classés en risque intermédiaire.
Tout à fait. Et en 2022 une seconde révision a donc été proposée avec le score R2-ISS, qui intègre des anomalies supplémentaires, telles que le gain 1q, reconnues comme étant associées à un pronostic défavorable.
Parallèlement aux scores internationaux validés par l’IMWG, l’IFM a développé un score spécifique : le LP-Score. Contrairement aux précédents, ce score est exclusivement basé sur 5 anomalies cytogénétiques considérées comme à risque :
- Délétion 17p
- Délétion 1p32
- Gain 1q
- Translocation (4;14)
- Trisomie 21.4
Et le LP-score intègre également une anomalie considérée comme protectrice : la trisomie 5.
Chaque anomalie se voit attribuer un coefficient, et la somme des coefficients permet de classer les patients en trois catégories de risque : risque favorable, Risque intermédiaire et Haut risque.
En 2022, deux scores coexistent donc dans la pratique : le R2-ISS, utilisé à l’échelle internationale, et le LP-Score, plus répandu en France.
Aujourd’hui, comment est défini un myélome multiple de haut risque cytogénétique ?
Face à l’absence de consensus clair sur la notion de « haut risque » dans le myélome multiple, notamment à l’ère des traitements innovants, la Société Internationale du Myélome s’est récemment réunie pour proposer une définition actualisée. Cette nouvelle classification a été publiée dans le Journal of Clinical Oncology.
Elle repose sur quatre critères cytogénétiques majeurs. Voici les critères cytogénétiques retenus pour définir un haut risque :
- Un premier groupe avec la présence d’une délétion 17p et/ou la présence d’une mutation de TP53
- Un deuxième critère avec la présence d’une délétion 1p32 bi-allélique
- Un troisième groupe qui concerne l’association du gain du bras long du chromosome 1 (le gain 1q) avec une délétion 1p32 monoallélique
- Et enfin un quatrième groupe qui porte sur l’association entre un gain 1q ou une délétion 1p32 monoallélique avec une translocation à risque, parmi les 3 suivantes :
- La t(4;14)
- La t(14;16)
- Et la t(14;20)
En complément de ces 4 critères cytogénétiques, le consensus a ajouté un critère biochimique qui est la présence d’un taux élevé de bêta-2 microglobuline chez les patients qui ont une fonction rénale préservée, autrement dit une créatinine normale.
Enfin, le consensus a précisé qu’une délétion 17p était considérée comme significative lorsqu’elle est présente dans plus de 20 % des plasmocytes tumoraux. Cette définition a toutefois suscité un certain débat, car certaines études suggèrent que lorsque la délétion 17p ne concerne pas la majorité des plasmocytes, elle pourrait correspondre à un profil à risque intermédiaire plutôt qu’à un haut risque avéré. Quoi qu’il en soit, il est essentiel, lors d’une recherche de délétion 17p par FISH, de préciser systématiquement le pourcentage de plasmocytes porteurs de l’anomalie afin d’affiner le pronostic.
Alors, j’ajouterais une chose : cette définition a été pensée pour qu’environ 20 % des patients nouvellement diagnostiqués soient classés comme « haut risque ». À titre de comparaison, dans la précédente classification internationale, le stade R-ISS III et le score LP haut risque de l’IFM ne concernaient qu’environ 15 % des patients.
Et comment est défini un myélome multiple d’ultra-haut risque ?
Le consensus IMS n’a pas défini formellement le concept d’ultra-haut risque cytogénétique. En pratique, on se base sur des critères cliniques, notamment la survie globale c’est-à-dire un décès dans les 2 ans après le diagnostic va être considéré comme un marqueur d’ultra-haut risque. Une survie inférieure à 3 ans correspond à un haut risque.
D’un point de vue génétique, certains cliniciens considèrent qu’une combinaison de deux anomalies de mauvais pronostic (par exemple un gain 1q + une translocation (4;14)) peut suggérer un profil « ultra-haut risque ». Cependant, cette approche reste empirique et n’est pas encore standardisée.
Il existe néanmoins des profils biologiquement très défavorables, par exemple l’association d’une délétion 17p et d’une mutation TP53, qui entraînent une inactivation bi-allélique de TP53. Ce type de myélome est reconnu comme particulièrement agressif, bien que non encore officiellement catalogué comme « ultra-haut risque » dans les classifications actuelles.
L’un des objectifs du consensus a été de clarifier ces situations confuses : certains profils autrefois considérés comme « ultra-haut risque » sont désormais intégrés dans la nouvelle catégorie dite de « haut risque », grâce à une meilleure précision des outils de diagnostic.
La nouvelle définition permet de reclasser un certain nombre de patients, notamment ceux qui étaient autrefois considérés comme à risque intermédiaire dans le R-ISS. Par exemple, tous les patients au stade R-ISS II porteurs d’une délétion 17p sont désormais automatiquement considérés comme haut risque. On pourrait estimer de manière empirique qu’environ 1 patient sur 5 classé en haut risque selon cette nouvelle définition pourrait relever du profil « ultra-haut risque », mais bien sûr ce sous-groupe reste à mieux caractériser dans les années à venir.
Quels défis subsistent aujourd’hui pour stratifier avec encore davantage de précision les patients dans la catégorie des haut risques ?
L’un des grands enjeux, c’est d’avoir accès à des cohortes suffisamment larges. C’est ce qui a permis, par exemple, à Anaïs d’identifier la double délétion 1p32, une anomalie rare mais à fort impact pronostique. Le myélome est une maladie très hétérogène et, sans un nombre important de patients, on risque de passer à côté de facteurs extrêmement péjoratifs qui ne concernent qu’une petite minorité. C’est pour ça que les grandes cohortes sont essentielles.
Un autre défi, c’est celui de l’hétérogénéité spatiale. Chez certains patients, si on compare un prélèvement sternal et un prélèvement iliaque, on peut ne pas retrouver les mêmes anomalies cytogénétiques. Il arrive qu’un patient soit classé « risque standard » dans le sternum, et « haut risque » dans le bassin. Pourtant, son pronostic global est bien celui d’un « haut risque ». C’est ce qui pousse aujourd’hui au développement d’outils capables de détecter les anomalies cytogénétiques directement dans le sang. Il y a encore une quinzaine d’années, on pensait qu’il n’y avait pas de plasmocytes tumoraux circulants dans le myélome. Mais avec les nouvelles techniques de cytométrie en flux plus sensibles, on sait aujourd’hui qu’il y en a un petit pourcentage circulant. Et ce taux de cellules tumorales circulantes a un impact pronostique. Plusieurs équipes européennes ont identifié un seuil pronostique autour de 0,02 % : au-delà de ce seuil, le pronostic est plus défavorable.
Donc il y a à la fois un aspect quantitatif — plus il y a de cellules en circulation, plus c’est péjoratif — et un aspect qualitatif, car si on peut séquencer ces cellules, on pourrait accéder théoriquement à l’hétérogénéité génétique sans passer par des prélèvements médullaires multiples.
Et au-delà de la génétique, il faudra aussi prendre en compte le microenvironnement tumoral, en particulier l’état du système immunitaire du patient. On sait par exemple que la qualité des lymphocytes T influence la réponse aux immunothérapies. Ce sont des aspects qui restent encore à explorer plus en profondeur.
Ajoutons que même si aujourd’hui les panels NGS sont courants, ils ne donnent qu’une partie des informations. En séquençant l’intégralité du génome, on peut accéder à des données qu’on ne voit pas avec un panel classique, par exemple, certains marqueurs d’instabilité génétique comme la signature mutationnelle APOBEC. Et plus une tumeur est instable, plus elle est agressive. L’un des grands défis à venir, ce sera donc de rendre ces données accessibles en pratique, même si on ne peut pas faire un séquençage complet du génome de tous les patients à grande échelle pour le moment.
Enfin, il y a la question de l’intégration de toutes ces données — génétiques, immunitaires, cytométriques — pour obtenir une évaluation personnalisée du risque et proposer des traitements mieux adaptés. Là-dessus, l’intelligence artificielle jouera sans doute un rôle important : elle pourrait nous aider à croiser ces informations complexes pour affiner les prises de décision.
Dans le futur, pourrait-on envisager des définitions de haut risque basées sur le niveau de MRD après l’induction ?
Aujourd’hui, on s’appuie principalement sur des éléments présents au diagnostic : les anomalies cytogénétiques, la bêta-2, la présence éventuelle de cellules tumorales circulantes, etc. Mais ce qui est aussi majeur, c’est : « qu’est-ce qui se passe ensuite ? ».
Oui, c’est là qu’on entre dans la notion de haut risque fonctionnel. Autrement dit : comment le patient répond au traitement ? Et c’est probablement cette intersection entre le niveau de risque initial et la qualité de la réponse thérapeutique qui sera clé à l’avenir.
Aujourd’hui, le meilleur critère pour évaluer cette réponse, c’est la maladie résiduelle minimale, la MRD. Et ce qu’il faut retenir, c’est que chez un patient à haut risque, le fait d’obtenir une MRD indétectable maintenue dans le temps doit devenir un objectif thérapeutique à part entière.
Voilà... Je pense qu’on a abordé l’essentiel sur la thématique « Définir et comprendre le myélome multiple de haut risque cytogénétique ». Merci à tous pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dédié au myélome de haut risque. Vous pouvez retrouver cet épisode et le suivant sur le site Sanofi Campus. A bientôt !
4. Perrot A et al. Development and Validation of a Cytogenetic Prognostic Index Predicting Survival in Multiple Myeloma. J Clin Oncol. 2019;37(19):1657-1665.
Bonjour à tous, je suis le Professeur Jill Corre.
Bonjour, je suis Anaïs Schavgoulidze.
Anaïs et moi sommes toutes deux biologistes médicales à l’Unité de Génomique du Myélome au CHU de Toulouse, et nous appartenons à une équipe de recherche dédiée à l’étude de la génomique et l’immunologie du myélome au Centre de recherches en cancérologie de Toulouse.
Bienvenue dans ce 1er épisode de ce podcast consacré au myélome multiple de haut risque cytogénétique. Aujourd’hui, nous allons retracer l’évolution des critères de définition du haut risque, revenir sur les avancées les plus récentes du consensus international et évoquer des pistes pour le futur...
Alors quels ont été les premiers critères pour identifier les myélomes multiples de haut risque et comment la définition de « haut risque » a-t-elle évolué au fil des années ?
À l’origine, la définition du myélome multiple à haut risque reposait sur des critères purement biochimiques, principalement le taux de bêta-2 microglobuline et l’albumine. En parallèle, des études ont commencé à explorer l’impact pronostique des anomalies cytogénétiques portées par les plasmocytes tumoraux, notamment la délétion du chromosome 13.
En 2015, la classification ISS initialement fondée uniquement sur des paramètres biochimiques a été révisée pour donner naissance au score R-ISS. Ce dernier a intégré pour la première fois trois anomalies cytogénétiques considérées comme de haut risque :
- La délétion 17p
- La translocation (4;14)
- La translocation (14;16).
Cependant, ce score n’a pas fait l’unanimité. Certaines études ont montré que le R-ISS ne permettait pas toujours d’identifier avec précision tous les patients à haut risque, certains étant à tort classés en risque intermédiaire.
Tout à fait. Et en 2022 une seconde révision a donc été proposée avec le score R2-ISS, qui intègre des anomalies supplémentaires, telles que le gain 1q, reconnues comme étant associées à un pronostic défavorable.
Parallèlement aux scores internationaux validés par l’IMWG, l’IFM a développé un score spécifique : le LP-Score. Contrairement aux précédents, ce score est exclusivement basé sur 5 anomalies cytogénétiques considérées comme à risque :
- Délétion 17p
- Délétion 1p32
- Gain 1q
- Translocation (4;14)
- Trisomie 21.4
Et le LP-score intègre également une anomalie considérée comme protectrice : la trisomie 5.
Chaque anomalie se voit attribuer un coefficient, et la somme des coefficients permet de classer les patients en trois catégories de risque : risque favorable, Risque intermédiaire et Haut risque.
En 2022, deux scores coexistent donc dans la pratique : le R2-ISS, utilisé à l’échelle internationale, et le LP-Score, plus répandu en France.
Aujourd’hui, comment est défini un myélome multiple de haut risque cytogénétique ?
Face à l’absence de consensus clair sur la notion de « haut risque » dans le myélome multiple, notamment à l’ère des traitements innovants, la Société Internationale du Myélome s’est récemment réunie pour proposer une définition actualisée. Cette nouvelle classification a été publiée dans le Journal of Clinical Oncology.
Elle repose sur quatre critères cytogénétiques majeurs. Voici les critères cytogénétiques retenus pour définir un haut risque :
- Un premier groupe avec la présence d’une délétion 17p et/ou la présence d’une mutation de TP53
- Un deuxième critère avec la présence d’une délétion 1p32 bi-allélique
- Un troisième groupe qui concerne l’association du gain du bras long du chromosome 1 (le gain 1q) avec une délétion 1p32 monoallélique
- Et enfin un quatrième groupe qui porte sur l’association entre un gain 1q ou une délétion 1p32 monoallélique avec une translocation à risque, parmi les 3 suivantes :
- La t(4;14)
- La t(14;16)
- Et la t(14;20)
En complément de ces 4 critères cytogénétiques, le consensus a ajouté un critère biochimique qui est la présence d’un taux élevé de bêta-2 microglobuline chez les patients qui ont une fonction rénale préservée, autrement dit une créatinine normale.
Enfin, le consensus a précisé qu’une délétion 17p était considérée comme significative lorsqu’elle est présente dans plus de 20 % des plasmocytes tumoraux. Cette définition a toutefois suscité un certain débat, car certaines études suggèrent que lorsque la délétion 17p ne concerne pas la majorité des plasmocytes, elle pourrait correspondre à un profil à risque intermédiaire plutôt qu’à un haut risque avéré. Quoi qu’il en soit, il est essentiel, lors d’une recherche de délétion 17p par FISH, de préciser systématiquement le pourcentage de plasmocytes porteurs de l’anomalie afin d’affiner le pronostic.
Alors, j’ajouterais une chose : cette définition a été pensée pour qu’environ 20 % des patients nouvellement diagnostiqués soient classés comme « haut risque ». À titre de comparaison, dans la précédente classification internationale, le stade R-ISS III et le score LP haut risque de l’IFM ne concernaient qu’environ 15 % des patients.
Et comment est défini un myélome multiple d’ultra-haut risque ?
Le consensus IMS n’a pas défini formellement le concept d’ultra-haut risque cytogénétique. En pratique, on se base sur des critères cliniques, notamment la survie globale c’est-à-dire un décès dans les 2 ans après le diagnostic va être considéré comme un marqueur d’ultra-haut risque. Une survie inférieure à 3 ans correspond à un haut risque.
D’un point de vue génétique, certains cliniciens considèrent qu’une combinaison de deux anomalies de mauvais pronostic (par exemple un gain 1q + une translocation (4;14)) peut suggérer un profil « ultra-haut risque ». Cependant, cette approche reste empirique et n’est pas encore standardisée.
Il existe néanmoins des profils biologiquement très défavorables, par exemple l’association d’une délétion 17p et d’une mutation TP53, qui entraînent une inactivation bi-allélique de TP53. Ce type de myélome est reconnu comme particulièrement agressif, bien que non encore officiellement catalogué comme « ultra-haut risque » dans les classifications actuelles.
L’un des objectifs du consensus a été de clarifier ces situations confuses : certains profils autrefois considérés comme « ultra-haut risque » sont désormais intégrés dans la nouvelle catégorie dite de « haut risque », grâce à une meilleure précision des outils de diagnostic.
La nouvelle définition permet de reclasser un certain nombre de patients, notamment ceux qui étaient autrefois considérés comme à risque intermédiaire dans le R-ISS. Par exemple, tous les patients au stade R-ISS II porteurs d’une délétion 17p sont désormais automatiquement considérés comme haut risque. On pourrait estimer de manière empirique qu’environ 1 patient sur 5 classé en haut risque selon cette nouvelle définition pourrait relever du profil « ultra-haut risque », mais bien sûr ce sous-groupe reste à mieux caractériser dans les années à venir.
Quels défis subsistent aujourd’hui pour stratifier avec encore davantage de précision les patients dans la catégorie des haut risques ?
L’un des grands enjeux, c’est d’avoir accès à des cohortes suffisamment larges. C’est ce qui a permis, par exemple, à Anaïs d’identifier la double délétion 1p32, une anomalie rare mais à fort impact pronostique. Le myélome est une maladie très hétérogène et, sans un nombre important de patients, on risque de passer à côté de facteurs extrêmement péjoratifs qui ne concernent qu’une petite minorité. C’est pour ça que les grandes cohortes sont essentielles.
Un autre défi, c’est celui de l’hétérogénéité spatiale. Chez certains patients, si on compare un prélèvement sternal et un prélèvement iliaque, on peut ne pas retrouver les mêmes anomalies cytogénétiques. Il arrive qu’un patient soit classé « risque standard » dans le sternum, et « haut risque » dans le bassin. Pourtant, son pronostic global est bien celui d’un « haut risque ». C’est ce qui pousse aujourd’hui au développement d’outils capables de détecter les anomalies cytogénétiques directement dans le sang. Il y a encore une quinzaine d’années, on pensait qu’il n’y avait pas de plasmocytes tumoraux circulants dans le myélome. Mais avec les nouvelles techniques de cytométrie en flux plus sensibles, on sait aujourd’hui qu’il y en a un petit pourcentage circulant. Et ce taux de cellules tumorales circulantes a un impact pronostique. Plusieurs équipes européennes ont identifié un seuil pronostique autour de 0,02 % : au-delà de ce seuil, le pronostic est plus défavorable.
Donc il y a à la fois un aspect quantitatif — plus il y a de cellules en circulation, plus c’est péjoratif — et un aspect qualitatif, car si on peut séquencer ces cellules, on pourrait accéder théoriquement à l’hétérogénéité génétique sans passer par des prélèvements médullaires multiples.
Et au-delà de la génétique, il faudra aussi prendre en compte le microenvironnement tumoral, en particulier l’état du système immunitaire du patient. On sait par exemple que la qualité des lymphocytes T influence la réponse aux immunothérapies. Ce sont des aspects qui restent encore à explorer plus en profondeur.
Ajoutons que même si aujourd’hui les panels NGS sont courants, ils ne donnent qu’une partie des informations. En séquençant l’intégralité du génome, on peut accéder à des données qu’on ne voit pas avec un panel classique, par exemple, certains marqueurs d’instabilité génétique comme la signature mutationnelle APOBEC. Et plus une tumeur est instable, plus elle est agressive. L’un des grands défis à venir, ce sera donc de rendre ces données accessibles en pratique, même si on ne peut pas faire un séquençage complet du génome de tous les patients à grande échelle pour le moment.
Enfin, il y a la question de l’intégration de toutes ces données — génétiques, immunitaires, cytométriques — pour obtenir une évaluation personnalisée du risque et proposer des traitements mieux adaptés. Là-dessus, l’intelligence artificielle jouera sans doute un rôle important : elle pourrait nous aider à croiser ces informations complexes pour affiner les prises de décision.
Dans le futur, pourrait-on envisager des définitions de haut risque basées sur le niveau de MRD après l’induction ?
Aujourd’hui, on s’appuie principalement sur des éléments présents au diagnostic : les anomalies cytogénétiques, la bêta-2, la présence éventuelle de cellules tumorales circulantes, etc. Mais ce qui est aussi majeur, c’est : « qu’est-ce qui se passe ensuite ? ».
Oui, c’est là qu’on entre dans la notion de haut risque fonctionnel. Autrement dit : comment le patient répond au traitement ? Et c’est probablement cette intersection entre le niveau de risque initial et la qualité de la réponse thérapeutique qui sera clé à l’avenir.
Aujourd’hui, le meilleur critère pour évaluer cette réponse, c’est la maladie résiduelle minimale, la MRD. Et ce qu’il faut retenir, c’est que chez un patient à haut risque, le fait d’obtenir une MRD indétectable maintenue dans le temps doit devenir un objectif thérapeutique à part entière.
Voilà... Je pense qu’on a abordé l’essentiel sur la thématique « Définir et comprendre le myélome multiple de haut risque cytogénétique ». Merci à tous pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dédié au myélome de haut risque. Vous pouvez retrouver cet épisode et le suivant sur le site Sanofi Campus. A bientôt !
4. Perrot A et al. Development and Validation of a Cytogenetic Prognostic Index Predicting Survival in Multiple Myeloma. J Clin Oncol. 2019;37(19):1657-1665.
Dans cet épisode, Anaïs Schavgoulidze présente les différents outils qui permettent d’identifier précisément les anomalies cytogénétiques : FISH et NGS. Elle évoque aussi les conséquences éventuelles liées à la nouvelle définition du myélome multiple à haut risque : mise en place d’essais cliniques spécifiquement dédiés aux patients à haut risque, prises en charge plus adaptées, développement de stratégies de maintenance plus efficaces...
Bonjour, je suis Anaïs Schavgoulidze. Bonjour je suis Jill Corre.
Nous sommes biologistes médicales à l’Unité de Génomique du Myélome au CHU de Toulouse, et nous appartenons à une équipe de recherche dédiée à l’étude de la génomique et l’immunologie du myélome au Centre de recherches en cancérologie de Toulouse.
Bienvenue dans ce 2ème épisode de ce podcast consacré au myélome multiple de haut risque cytogénétique. Aujourd’hui, nous allons parler outils diagnostiques et enjeux thérapeutiques.
Alors j’ai quelques questions pour toi Anaïs. Tout d’abord, quels sont les principaux outils qui permettent d’identifier précisément les anomalies cytogénétiques ?
Dans le myélome, le caryotype conventionnel, qui est pourtant une technique de base dans la plupart des hémopathies, est totalement inadapté. On utilise plutôt des techniques spécifiques, développées à partir de plasmocytes triés par tri immunomagnétique, c’est une vraie particularité du myélome. Et une fois ces cellules isolées, deux grands outils sont utilisés en pratique aujourd’hui : la FISH et les panels NGS.
Alors, rentrons un peu dans le détail de ces deux outils… La FISH tout d’abord. Elle est disponible dans tous les laboratoires de cytogénétique. C’est la technique la plus répandue, mais avec l’apparition des nouveaux scores de risque cytogénétique, on devrait théoriquement réaliser entre 6 et 8 FISH différentes pour couvrir toutes les anomalies pertinentes. Malheureusement, pour des raisons budgétaires, les laboratoires n’en font qu’une, généralement celle ciblant la délétion 17p, ce qui limite forcément l’informativité de l’analyse.
Les panels NGS, eux, ne sont accessibles que dans des laboratoires plus spécialisés. Actuellement, seulement deux centres publics en France proposent ce type d’analyse dédiée au myélome. Concrètement, pour réaliser un panel NGS, on extrait l’ADN des plasmocytes triés, on prépare une librairie et on capte les régions d’intérêt. L’intérêt du NGS, c’est qu’avec une seule technique, on peut obtenir l’ensemble des informations : anomalies de nombre, mutations, et même certaines translocations, comme la t(11;14), qui peut avoir un impact théranostique. Un point important : certaines anomalies très focales, comme une délétion bi-allélique de la 1p32, peuvent être manquées par la FISH mais bien détectées par le panel NGS.
C’est pour toutes ces raisons que, dans la pratique, beaucoup de cliniciens se tournent aujourd’hui vers le panel NGS. Enfin, on peut mentionner une technique émergente : l’Optical Genome Mapping, ou OGM, qui pourrait à terme devenir une alternative au caryotype et à la FISH. Elle commence à susciter un réel intérêt dans le myélome.
Comment les nouvelles définitions des myélomes multiples à haut risque influencent-elles les choix thérapeutiques et la prise en charge quotidienne des patients ?
A l’heure actuelle, il est fortement recommandé d’orienter les jeunes patients de haut risque vers l’autogreffe. Pour ces mêmes patients, les cliniciens essaient de les intégrer dans des essais cliniques, notamment sur des protocoles de maintenance intensifiée.
Des résultats d’études chez les patients âgés non éligibles à la greffe, avec une comparaison triplet vs quadruplet, montrent une meilleure efficacité de la quadruplet chez les patients à haut risque sur des données de MRD.
Pour l’instant, aucune molécule n’a clairement démontré sa capacité à compenser un haut risque cytogénétique, on observe encore des rechutes sous les nouveaux traitements d’immunothérapie. Prenons l’exemple des patients avec une délétion 17p, nous avons observé des associations plus fréquentes entre une délétion 17p et une délétion de BCMA, ce qui suggère un facteur favorisant de résistance plus rapide aux traitements anti-BCMA.
Quels bénéfices ces nouvelles définitions pourront-elles apporter en termes de survie et de qualité de vie pour les patients ?
L’espoir, c’est que ces nouvelles définitions permettent enfin de construire des essais cliniques spécifiquement dédiés aux patients à haut risque, avec des critères consensuels, partagés par tous. Aujourd’hui, la plupart des essais incluent des patients tout-venant, qu’on stratifie ensuite selon le risque. Mais on se retrouve avec des sous-groupes très réduits, ce qui rend les analyses très difficiles, et l’interprétation des données parfois hasardeuse. Avec une définition claire du haut risque, on pourrait vraiment encourager les promoteurs académiques et l’industrie pharmaceutique à concevoir des protocoles ciblés spécifiquement pour ces patients.
Le patient à haut risque, c’est un peu le « parent pauvre » du myélome : on sait qu’il a un mauvais pronostic, mais l’adaptation thérapeutique ne suit pas. Aujourd’hui encore, le traitement est principalement déterminé par l’âge et l’éligibilité à l’intensification, pas par le profil cytogénétique. Alors qu’en réalité, dès qu’un patient est identifié comme haut risque cytogénétique, il faudrait probablement en faire plus. C’est ce qui a conduit à envisager des stratégies comme la double autogreffe. Cela dit, des essais pourraient venir remettre en question cette approche. On est donc à un tournant. Ce qu’on voit, c’est que les cliniciens souhaitent pouvoir adapter leurs traitements au niveau de risque réel. Ils voient bien que ces patients vont moins bien… mais pour l’instant, on manque de réponses effectives.
Alors quelles pourraient être les nouvelles stratégies thérapeutiques pour le myélome multiple à haut risque cytogénétique ?
Ce que l’on constate avec les patients à haut risque, c’est qu’ils ont un risque de rechute plus rapide, même après une bonne réponse initiale. Donc l’objectif, ce serait de développer des stratégies de maintenance plus efficaces, plus longues, que celles qu’on propose actuellement en routine.
Par exemple, dans un essai, certains patients ont vu leur traitement interrompu après avoir atteint deux MRD négatives consécutives. Mais chez les patients à haut risque cytogénétique, même s’ils étaient MRD négatifs, on a observé des rechutes précoces après l’arrêt du traitement.
Cela montre bien que chez ces patients, on ne peut sans doute pas appliquer les mêmes stratégies d’arrêt que pour les autres. Il faudra probablement envisager des maintenances plus longues, voire personnalisées, en fonction du profil de risque.
Merci Anaïs, merci à tous pour votre écoute. J’espère que ce podcast a répondu à vos attentes. Vous pouvez retrouver cet épisode et le précédent ainsi que la première saison sur la maladie résiduelle sur le site Sanofi Campus.
Bonjour, je suis Anaïs Schavgoulidze. Bonjour je suis Jill Corre.
Nous sommes biologistes médicales à l’Unité de Génomique du Myélome au CHU de Toulouse, et nous appartenons à une équipe de recherche dédiée à l’étude de la génomique et l’immunologie du myélome au Centre de recherches en cancérologie de Toulouse.
Bienvenue dans ce 2ème épisode de ce podcast consacré au myélome multiple de haut risque cytogénétique. Aujourd’hui, nous allons parler outils diagnostiques et enjeux thérapeutiques.
Alors j’ai quelques questions pour toi Anaïs. Tout d’abord, quels sont les principaux outils qui permettent d’identifier précisément les anomalies cytogénétiques ?
Dans le myélome, le caryotype conventionnel, qui est pourtant une technique de base dans la plupart des hémopathies, est totalement inadapté. On utilise plutôt des techniques spécifiques, développées à partir de plasmocytes triés par tri immunomagnétique, c’est une vraie particularité du myélome. Et une fois ces cellules isolées, deux grands outils sont utilisés en pratique aujourd’hui : la FISH et les panels NGS.
Alors, rentrons un peu dans le détail de ces deux outils… La FISH tout d’abord. Elle est disponible dans tous les laboratoires de cytogénétique. C’est la technique la plus répandue, mais avec l’apparition des nouveaux scores de risque cytogénétique, on devrait théoriquement réaliser entre 6 et 8 FISH différentes pour couvrir toutes les anomalies pertinentes. Malheureusement, pour des raisons budgétaires, les laboratoires n’en font qu’une, généralement celle ciblant la délétion 17p, ce qui limite forcément l’informativité de l’analyse.
Les panels NGS, eux, ne sont accessibles que dans des laboratoires plus spécialisés. Actuellement, seulement deux centres publics en France proposent ce type d’analyse dédiée au myélome. Concrètement, pour réaliser un panel NGS, on extrait l’ADN des plasmocytes triés, on prépare une librairie et on capte les régions d’intérêt. L’intérêt du NGS, c’est qu’avec une seule technique, on peut obtenir l’ensemble des informations : anomalies de nombre, mutations, et même certaines translocations, comme la t(11;14), qui peut avoir un impact théranostique. Un point important : certaines anomalies très focales, comme une délétion bi-allélique de la 1p32, peuvent être manquées par la FISH mais bien détectées par le panel NGS.
C’est pour toutes ces raisons que, dans la pratique, beaucoup de cliniciens se tournent aujourd’hui vers le panel NGS. Enfin, on peut mentionner une technique émergente : l’Optical Genome Mapping, ou OGM, qui pourrait à terme devenir une alternative au caryotype et à la FISH. Elle commence à susciter un réel intérêt dans le myélome.
Comment les nouvelles définitions des myélomes multiples à haut risque influencent-elles les choix thérapeutiques et la prise en charge quotidienne des patients ?
A l’heure actuelle, il est fortement recommandé d’orienter les jeunes patients de haut risque vers l’autogreffe. Pour ces mêmes patients, les cliniciens essaient de les intégrer dans des essais cliniques, notamment sur des protocoles de maintenance intensifiée.
Des résultats d’études chez les patients âgés non éligibles à la greffe, avec une comparaison triplet vs quadruplet, montrent une meilleure efficacité de la quadruplet chez les patients à haut risque sur des données de MRD.
Pour l’instant, aucune molécule n’a clairement démontré sa capacité à compenser un haut risque cytogénétique, on observe encore des rechutes sous les nouveaux traitements d’immunothérapie. Prenons l’exemple des patients avec une délétion 17p, nous avons observé des associations plus fréquentes entre une délétion 17p et une délétion de BCMA, ce qui suggère un facteur favorisant de résistance plus rapide aux traitements anti-BCMA.
Quels bénéfices ces nouvelles définitions pourront-elles apporter en termes de survie et de qualité de vie pour les patients ?
L’espoir, c’est que ces nouvelles définitions permettent enfin de construire des essais cliniques spécifiquement dédiés aux patients à haut risque, avec des critères consensuels, partagés par tous. Aujourd’hui, la plupart des essais incluent des patients tout-venant, qu’on stratifie ensuite selon le risque. Mais on se retrouve avec des sous-groupes très réduits, ce qui rend les analyses très difficiles, et l’interprétation des données parfois hasardeuse. Avec une définition claire du haut risque, on pourrait vraiment encourager les promoteurs académiques et l’industrie pharmaceutique à concevoir des protocoles ciblés spécifiquement pour ces patients.
Le patient à haut risque, c’est un peu le « parent pauvre » du myélome : on sait qu’il a un mauvais pronostic, mais l’adaptation thérapeutique ne suit pas. Aujourd’hui encore, le traitement est principalement déterminé par l’âge et l’éligibilité à l’intensification, pas par le profil cytogénétique. Alors qu’en réalité, dès qu’un patient est identifié comme haut risque cytogénétique, il faudrait probablement en faire plus. C’est ce qui a conduit à envisager des stratégies comme la double autogreffe. Cela dit, des essais pourraient venir remettre en question cette approche. On est donc à un tournant. Ce qu’on voit, c’est que les cliniciens souhaitent pouvoir adapter leurs traitements au niveau de risque réel. Ils voient bien que ces patients vont moins bien… mais pour l’instant, on manque de réponses effectives.
Alors quelles pourraient être les nouvelles stratégies thérapeutiques pour le myélome multiple à haut risque cytogénétique ?
Ce que l’on constate avec les patients à haut risque, c’est qu’ils ont un risque de rechute plus rapide, même après une bonne réponse initiale. Donc l’objectif, ce serait de développer des stratégies de maintenance plus efficaces, plus longues, que celles qu’on propose actuellement en routine.
Par exemple, dans un essai, certains patients ont vu leur traitement interrompu après avoir atteint deux MRD négatives consécutives. Mais chez les patients à haut risque cytogénétique, même s’ils étaient MRD négatifs, on a observé des rechutes précoces après l’arrêt du traitement.
Cela montre bien que chez ces patients, on ne peut sans doute pas appliquer les mêmes stratégies d’arrêt que pour les autres. Il faudra probablement envisager des maintenances plus longues, voire personnalisées, en fonction du profil de risque.
Merci Anaïs, merci à tous pour votre écoute. J’espère que ce podcast a répondu à vos attentes. Vous pouvez retrouver cet épisode et le précédent ainsi que la première saison sur la maladie résiduelle sur le site Sanofi Campus.
250715090499GD - 09/2025
